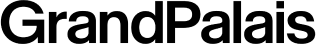Biographies des artistes
Valerio Adami
1935, Boulogne. Vit et travaille à Monaco et à Meina (Italie).
Adami apprend le dessin à l’Accademia di Belle Arti di Brera à Milan de 1951 à 1954 à partir des grands modèles de l’art antique et néoclassique. Ses premières toiles sont teintées d’expressionnisme et marquées par ses souvenirs de l’Italie de 1945 en ruines. A l’occasion du Salon de Mai à Paris en 1952, il rencontre les peintres Matta et Wilfredo Lam, qui deviennent ses plus proches amis en 1955.
Les peintures d’Adami, très graphiques, proposent des formes, des morceaux d’images, des silhouettes, mais la dislocation formelle, les combinaisons imprévisibles, qui doivent beaucoup au cubisme et à l’oeuvre de Matta, perturbent le regard. A partir de 1954, il séjourne
à Londres, proche d’artistes comme Richard Hamilton, Francis Bacon ; après 1961, il partage son temps entre Milan, Londres et Paris. Il s’affirme au cours des années soixante comme un représentant majeur de la Nouvelle figuration, participant à {Figuration narrative dans l’art
contemporain} (1965), {Bande dessinée et figuration narrative} (1967) et faisant l’objet d’une rétrospective à l’ARC en 1970. Sa notoriété est rapidement internationale, exposant à la Documenta III de Kassel (1964), à la galerie Schwarz de Milan (1965), à Bruxelles (1967), à la
Biennale de Venise (1968), au musée des Beaux-Arts de Caracas (1969).
En 1966, il établit définitivement son système formel : une ligne épaisse cerne les objets et personnages, traités en aplats de couleur pure et sans ombres. Les peintures sont précédées de dessins d’études particulièrement précis. Les variations portent les années suivantes sur la finesse du cerne, l’importance des hachures, l’ampleur des dislocations, la vivacité des contrastes.
La fin des années soixante est marquée par une évocation de lieux urbains, anonymes ou glauques inspirés par des photos qu’il prend de New York où il séjourne en 1966, au Chelsea Hotel de Londres et d’autres lieux au cours de ses voyages.
Durant les années soixante-dix, il met en place une méthode de montage et d’associations dont {Le portrait de James Joyce} (1971) est l’un des premiers exemples. A la banalité des intérieurs succède une peinture référentielle mais énigmatique, intégrant des lettres et des mots. Son travail porte sur la mémoire collective et culturelle, à travers des portraits de célébrités (Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Walter Benjamin), puis des paysages ou des événements historiques comme la Révolution française.
En 1978, il peint une série de tableaux aux sujets mythologiques dans son atelier de New-York, ponctués de références à la peinture ancienne, comme {Prométhée, Le Mythe de Pandore}. La ligne s’assouplit, la gamme colorée privilégie les tons naturels et n’a plus recours à la violence
des contrastes. De ses tableaux se dégage une impression de douceur nostalgique.
La franchise de ses aplats colorés trouve des applications à grande échelle dans des peintures murales dès 1974 pour la First National City Bank de Madison dans le Wisconsin, le hall de la gare d’Austerlitz (sur le thème du voyage de Persée) en 1987, le théâtre du Châtelet en 1989.
Eternel nomade, il change souvent d’atelier. Vivant à Paris et en Italie, il passe plusieurs mois à Ostende (1969), New York (à partir de 1971), Mexico et Los Angeles (1975), Monte Carlo (où il s’établit en 1981), Meina (Italie). Il entreprend de longs voyages, au Mexique (1969,
1981), en Inde (1977, 1982), dans les pays nordiques (1988).
Ouvert à l’interprétation, riche de nombreuses références culturelles, le travail d’Adami suscite de nombreux commentaires de philosophes (Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze), d’historiens d’art (Hubert Damisch, Marc Le Bot) et d’écrivains (Italo Calvino, Octavio Paz, Antonio Tabucchi).
Lui-même publie à partir de 1986 plusieurs ouvrages sur son travail comme {Les Règles du montage : Sinopie} (1989) ; {Dessiner : les gommes et les crayons} (2002).
Gilles Aillaud
1928, Paris – 2005, Paris.
Après des études de philosophie, Gilles Aillaud se tourne vers la peinture en 1949. Au début des années 1950, il utilise le collage de matériaux hétérogènes : plâtre, coton, grillage pour représenter un rapace ({Harfang}, 1951) ; du film plastique et du sable collé pour évoquer la mer et le rivage ({Mer et Grève}, 1951), autant de sujets qui constituent l’essentiel de son iconographie à venir. Il présente en 1952 ces collages et assemblages dans sa première exposition personnelle à la galerie Niepce à Paris. En 1959, il sort de son isolement volontaire pour exposer au salon de la Jeune Peinture, véritable laboratoire d’expériences plastiques et théoriques, dont il devient président en 1966.
En 1961, il rencontre Eduardo Arroyo avec qui il partage des similitudes dans ses conceptions artistiques et politiques. En
1964, Aillaud, Arroyo et Recalcati réalisent {Une passion dans le désert}, d’après une nouvelle de Balzac, qu’ils exposent à la galerie Saint-Germain à Paris, un ensemble de 13 tableaux qui revendiquent violemment le droit au récit en peinture. L’année suivante, les trois complices exécutent une suite de huit tableaux intitulée {Vivre et laisser mourir ou la Fin tragique de Marcel Duchamp}, présentée dans l’exposition de la galerie Creuze à Paris, {La Figuration narrative dans l’art contemporain}. La représentation de la mise à mort de l’inventeur du ready-made suscite un énorme scandale.
A partir de 1963-1964, Aillaud représente des animaux, seuls dans des zoos, enfermés dans des cages, des enclos, des verrières ou derrière des grilles, et qui tendent, par mimétisme, à se fondre dans leur milieu. En 1971, pour sa première exposition personnelle dans un musée, il
expose à l'ARC/Musée d'art moderne de la Ville de Paris les peintures réalisées depuis 1964.
L'exposition fut décrochée par l'artiste pour protester contre un acte de censure exercé par les pouvoirs publics sur l’un de ses confrères.
Les tableaux animaliers d’Aillaud traquent le moment fragile où l’immobilité du décor de zoo s’anime de la présence soudainement révélée d’une bête. Immobilisant l’instant, le peintre se propose non de décrire l’animal, mais de peindre sa relation avec l’espace qu’il habite.
Tantôt il plonge le spectateur dans la cage en multipliant les points de fuite ({Rhinocéros}, 1972, {La piscine vide}, 1974) tantôt il le rejette hors de cet espace ({Cage aux lions}, 1966, {Varan}, 1972, {Lamantin}, 1976). Parfois encore, il le place au-dessus de la fosse ({Crocodile}, 1971, {Hippopotame sous le jet}, 1979) ou en contrebas ({Eléphant et clous}, 1970). Par des détails, parfois à peine perceptibles, Aillaud dénonce l’artificialité du lieu.
Dans {L’amour polaire} (1964), on aperçoit la base des barreaux dans l’angle de la toile et un bout de tuyau traîner négligemment. {Eau} (1977-1978) laisse deviner une infime partie de mur flanqué d’une
bouche d’évacuation tandis qu’au milieu de {Rochers} (1977-1978) apparaissent trois petites pancartes. Ces éléments, inattendus ou insolites, sont autant de signes rappelant la présence de l’homme et le caractère factice du lieu. Plus tard, à partir des années 1980, les plages de la Grèce, les savanes africaines, les deltas du Nil ou d’ailleurs donne naissance à des images qui semblent déroulables à l’infini, comme des rouleaux de peinture chinoise ({Les Oiseaux du lac Nakuru}, 1990). Fasciné par ces espaces, Aillaud a souvent peint des paysages entre deux mondes, entre deux eaux, qui semblent à la fois apparaître et disparaître.
Auteur d’une pièce de théâtre ({Vermeer et Spinoza}, éd. Christian Bourgois, 1987), Aillaud réalise depuis 1972 de nombreux décors et des costumes pour le théâtre et l’opéra avec des metteurs en scène liés par la même quête d’un théâtre engagé : Jean Jourdheuil, ({Dans la jungle des villes de Brecht}, 1972), Klaus Michael Grüber pour la Schaubühne de Berlin ({les Bacchantes} d’Euripide, 1974, {Le roi Lear} de Shakespeare, 1985, {Parsifal} de Wagner, 1990, {Iphigénie en Tauride} de Goethe, 1996) ou Luc Bondy ({En attendant Godot} de Beckett,1999). A travers les auteurs et le répertoire qu’il aborde, Aillaud retrouve les préoccupations politiques et philosophiques qui nourrissent sa peinture.
Eduardo Arroyo
1937, Madrid. Vit et travaille à Madrid.
L’oeuvre d’Eduardo Arroyo est portée par une critique des pouvoirs et des traditions, une attention au quotidien et un humour permanent. Il établit des rapprochements visuels de mondes et de formes hétérogènes avec une redoutable précision.
Né à Madrid en 1937 en pleine guerre civile, il quitte l’Espagne franquiste en 1958 pour Paris. Parti pour être journaliste mais fasciné par la force de persuasion des images, il se tourne vers la peinture. Il tient sa première exposition en 1961 à la galerie Claude Levin, à
l’initiative de Georges Detais, impressionné par son premier envoi au Salon de la Jeune Peinture en 1960 et qui le soutient à ses débuts.
Durant les années soixante, il souligne avec ironie la faiblesse et le caractère conventionnel des mythes, de l’histoire de l’art ou de l’avant-garde artistique. Il intervient sur des reproductions de chefs-d’oeuvre de la peinture espagnole pour en détourner le sens.
Membre du Comité directeur du Salon de la Jeune Peinture de 1963 à 1969, il développe un goût pour les scandales en équipe.
Le premier est fomenté en 1963 à la troisième Biennale de Paris où il présente dans la salle "Abattoir" ses toiles {Les Quatre Dictateurs} qui déclenchent immédiatement la censure du gouvernement franquiste. Il est de toutes les aventures de la Figuration narrative : {Mythologies Quotidiennes} (1964), {Pop Art, Nouveau Réalisme, Nouvelle Figuration} à Vienne, Bruxelles, Berlin (1964), {Bande dessinée et figuration narrative} (1967).
Dans le cadre de l’exposition {La Figuration narrative dans l’art contemporain} organisée à la galerie Creuze, il présente la suite {Vivre et laisser mourir ou La Fin tragique de Marcel Ducham}p, peinte en 1965 avec Aillaud et Recalcati qui suscite les polémiques. En 1967, il
récidive et détourne dans la série {Miró refait} (galleria Il Fante di Spade, Rome, 1967 et galerie André Weill, Paris, 1969) les chefs-d’oeuvre du Catalan, indignant les derniers surréalistes.
C’est pour Arroyo une période de forte contestation politique. Il utilise l’anecdote pour soumettre « l’art de peindre à sa préoccupation idéologique », avec des expositions comme {Vingt-cinq ans de paix} (galeries André Schoeller Jr et Bernheim Jeune, Paris, 1965),
commentaire cynique de la campagne de propagande du régime franquiste. En 1965, il pense adhérer au Parti communiste, mais l’exclusion de Jorge Semprun l’en dissuade. De 1966 à 1972, il vit entre la France et l’Italie, avant de revenir à Paris. Il voyage à Cuba en 1967 et 1968, où son engagement passe par la réalisation d’oeuvres politiques collectives. Il imprime des affiches à l’atelier populaire des Beaux-Arts de Paris durant les évènements de mai 1968 et participe au projet de la {Salle rouge pour le Vietnam} (1969). En 1970-1971, il présente en Italie et à l’ARC la suite {Trente ans après}, critique caustique du régime de Franco à partir d’éléments collectés dans la société espagnole. Il refuse, comme beaucoup, de participer à l’exposition 72/72 : {Douze ans d’art contemporain en France} (1960 - 1972).
En 1975 et 1976, il séjourne à Berlin Ouest. La coupure de la ville en deux lui inspire l’exposition {Kreuzberg}. Son art du commentaire pictural atteint un sommet avec une copie grandeur nature de La Ronde de nuit de Rembrandt, dont il recrée les bords, critique implicite de la répression policière de la fin du franquisme. Il travaille avec Klaus Michael Grüber pour la mise en scène et les décors de la {Walkyrie} de Wagner, présentée en 1976 par l’Opéra de Paris.
Ses domaines de création sont multiples : auteur de la biographie du boxeur {Panama Al Brown} (1982), décorateur et auteur de théâtre ({Bantam}, 1986), il investit les techniques de la sculpture, la céramique, la lithographie. En 1977, après la mort du général Franco il peut enfin retourner en Espagne. Il vit alors la sensation d’être étranger chez lui, donnant naissance à la série des {Réflexions sur l’exil} (galerie Karl Flinker, Paris, 1978). Une exposition au Centre Pompidou en 1983 fait le point sur son parcours.
Durant les années quatre-vingts, il redécouvre son pays, sensible aux clichés de « l’espagnolade », avec les séries {Madrid-Paris-Madrid, Noche española}, 1988. La figure de Carmen Amaya, danseuse de flamenco célèbre dans les années quarante, envahit la série {Waldorf Astoria} à travers une débauche de tissus à pois, d’élégance hautaine, de mouvements passionnés. De nouveaux personnages apparaissent, comme le ramoneur ou le boxeur, métaphores du rôle de l’artiste. Si les thèmes changent, son oeuvre reste fondée sur le collage : « C’est
justement cet aspect sériel, fragmentaire, morcelé, ces différences stylistiques, ces mélanges [...] toute cette incohérence, qui font la cohérence de mon oeuvre. ». En 1998, le musée national espagnol de Reina Sofia lui consacre une rétrospective.
René Bertholo
1935, Portugal – 2005, Portugal.
Après une formation aux Beaux-Arts de Lisbonne, il part en 1957 avec Lourdès Castro à Munich, sur les pas de Paul Klee dont il admire les oeuvres. Il y rencontre Jan Voss, dont il sera très proche durant plus de dix ans. Ils s’installent tous trois à Paris en 1958 où ils publient avec Christo, Costa Pinheiro et Joao Vieira la revue sérigraphiée {KWY}.
Comptant 12 numéros jusqu’à 1963, cette publication accompagne l’essor naissant des livres d’artistes. Il édite parallèlement des portefeuilles de ses sérigraphies : {Livre Libre} (1960), {Il faut ce
qu’il faut} (1964).
Sa peinture, après un bref passage par l’abstraction, accumule des figures illustratives reconnaissables ou non, avec une forte dimension poétique, dans des espaces fractionnés ou juxtaposés. Il reprend l’éparpillement d’un Pollock, mais cherche à rompre avec l’abstraction.
Cette dispersion, le jeu sur la série, la répétition génère des histoires non linéaires. Il est alors proche du Pop Art par son utilisation des images de bandes dessinées, sa volonté de s’adresser au plus grand nombre, mais aussi du surréalisme dont il reprend l’approche
spontanée, automatique de l’image.
De 1962 à 1966, durant la période des « accumulations d’images » déclenchée notamment par la découverte du travail d’Arman, il est lié à la Figuration narrative, exposant à la galerie Mathias Fels (en 1965 et en 1966 avec Jan Voss) et participe à l’exposition {Mythologies
Quotidiennes} ; mais en désaccord avec la politisation du discours artistique, il s’éloigne du groupe dès 1965. Il privilégie la restitution d’images à partir de la mémoire, plutôt qu’une reproduction photographique, mécanique. La dimension poétique de ses peintures prend le dessus : « Ma situation [...] dans le mouvement artistique international consiste à mettre en images cette réalité urbaine à laquelle vous faites allusion. Seulement, l’ennui, c’est que j’ai des troubles de l’attention, alors je divague » écrit-il en préface de son exposition à la galerie Marzotto en 1967. La fresque murale (un type d’intervention d’artiste inexistant alors en France) qu’il réalise rue Dussoubs, à Paris en 1972, en est un aboutissement.
La série des {Modèles réduits}, exposée la première fois à Paris en 1970 à la galerie Lucien Durand l’occupe de 1967 à 1973. Il découpe et peint des formes simplifiées et colorées de paysages, de nuages de bateaux et de vagues. Ces formes sont animées par un moteur, évoquent le bricolage, les jeux d’enfants et introduisent le mouvement dans l’oeuvre d’art. Cet intérêt pour la machine se prolonge dans les années quatre-vingts avec la fabrication sur plusieurs années d’un synthétiseur artisanal de sons du quotidien, dans un esprit pataphysique.
A partir de 1977, toutes ses toiles sont fractionnées en une succession de saynètes, à la manière de films d’animation dont il manquerait des images intermédiaires, répondant à une
logique résolument onirique.
De 1972 à 1983, il réalise des sculptures qu’il qualifie de populaires, c’est-à-dire accessibles au plus grand nombre, pour les espaces publics comme la bibliothèque municipale de Quetigny ou l’Ecole nationale de la Batellerie à Châlons-sur-Saône.
A la fin des années soixante-dix, il retourne au Portugal. Il quitte alors le circuit international, le marché de l’art portugais au sortir de la dictature n’ayant pas de réseau hors du pays. Sa peinture continue jusqu’en 2005 (année de son décès) d’être une réflexion sur l’image et la machine.
Gianni Bertini
1922, Pise. Vit et travaille à Paris et en Italie.
L’oeuvre de Gianni Bertini est celle d’une personnalité truculente, foisonnante d’idées et souvent encline à la provocation.
Licencié de mathématiques, il réalise ses premières peintures en autodidacte, à partir de 1947, sont expressionnistes. En 1948-49, il peint la série des {Gridi} (« cris »), inspirés par les mots, chiffres et signaux routiers, ({ALT, LUNA, STOP}), dans l’esprit des peintures à
chiffres que Jasper Johns réalisera ultérieurement. Il rejoint ensuite les peintres de l’art informel et de l’abstraction géométrique du M.A.C. ({Movimento Arte Concreta}) à Milan. Les oeuvres de cette période sont présentées en octobre 1951 à la Galleria Numero de Florence.
Il s’installe à Paris en 1951 et intègre le courant informel de l’école de Paris, tenant sa première exposition personnelle en 1952 à la galerie Arnaud. De 1954 à 1963, il expose chaque année au Salon de Mai. La mythologie devient à partir de 1954 une source d’inspiration, avec
des oeuvres comme {Le Talent d’Ulysse}, {Actéon II surprend Artémis III}, {L’Affaire Jason}.
En 1956, il rencontre Pierre Restany qui le soutient tout au long de sa carrière ; il l’intègre en 1957 à {Espaces imaginaires}, une exposition à la galerie Kamer d’artistes à la recherche d’une spatialité nouvelle à travers une gestualité allusive.
A partir de 1960, la narration et la réflexion sur la société (à travers des peintures collages intégrant des caractères typographiques, des photos de presse) remplacent ses tentatives de définir l’espace par le geste et la couleur. A Venise à la galerie Gritti en 1962, lors de la manifestation du {Pays Réel}, il s’approprie, il « bertinise » des images de drapeaux, passeports en les maculant de peinture, ce qui lui vaut une fermeture de l’exposition par les autorités italiennes. En 1963, son oeuvre {Chiens de garde à vendre} sur laquelle il colle une photo de lui-même nu est reléguée dans les salles du fond du Salon de
Mai et déclenche une querelle qui se solde par une lettre de rupture avec le Salon. Proche du Nouveau Réalisme par ses procédés de reproduction mécanique, il mène une critique de la société. Il confronte des images de guerre, de buildings, d’automobiles ou d’avions à des
photographies de pin-up ou de sport. Ces associations d’images vulgaires et de citations picturales sont autant d’occasions indirectes de célébrer sa propre personnalité.
Dans le même temps, soutenu par Gérald Gassiot-Talabot, il participe aux expositions {Mythologies Quotidiennes}, {Figuration narrative} et {Le Monde en question}.
En 1965, il adhère au {Mec-Art}, abréviation de {mechanical art}. Les artistes de ce mouvement, Pol Bury, Jacquet, Rotella, réunis par Restany en 1965-1966, utilisent le procédé de reproduction mécanique de photographies sur tout support : émulsion ou sérigraphie sur toile,
tissu, plaque métallique. Bertini, l’artiste le plus actif du mouvement, photographie pendant une dizaine d’années des montages composites qu’il reporte sur des parties peintes.
Il crée à Milan deux revues de poésie visuelle : {Mec} en 1971 et {Lotta poetica} en 1972. La série de peintures {Abbaco}, fondée sur la citation et le mélange des genres (les madones portent des enfants déchiquetés par balles), inaugurée en 1976, vise à retrouver la présence de la grande peinture, à travers l’utilisation de l’image photographique.
A partir de 1982, il passe à une logique autoréférentielle, citant ses anciennes oeuvres dans ses créations nouvelles. Il séjourne un temps à Bratislava (Slovaquie) puis rentre à Paris. En 1991, il réalise un cycle d' oeuvres sur la guerre du Golfe, {Pour ne pas oublier} et en 1992 un
nouveau cycle sur {Antonin Artaud}. En 1997, il lance le manifeste de la « rétrogarde », qui revisite des principes du Mec-Art.
Plusieurs rétrospectives lui ont été consacrées, à Paris (Centre National des Arts Plastiques, 1984), Florence, Pise, et Arras (2002).
Henri Cueco
1929, Uzerche. Vit et travaille à Montmagny (Val d’Oise) et à Vigeois (Corrèze).
Le rapport de l’homme à la nature et le rôle social et politique de l’artiste engagé constituent les thèmes majeurs de la peinture d’Henri Cueco. Il grandit dans une région pauvre et rurale, le Limousin, et étudie la peinture avec son père. En 1947, il s’installe à Paris où
il dessine beaucoup, principalement des paysages et des natures mortes, et suit des cours à la Grande Chaumière. Il fréquente des peintres comme Rebeyrolle qui défendent, en pleine mode de
l’abstraction, la tradition de la figuration.
Cueco participe activement au Salon de la Jeune Peinture où il expose de 1952 à 1972. Il est d’abord membre du jury (1960), puis président (1962) et enfin lauréat (1963). Il réalise durant cette période des natures mortes, des portraits et des paysages. Il s’inspire des
moyens et techniques de la gravure pour réaliser ses dessins et sérigraphies : figures découpées, aplats de couleurs dont la gamme est réduite à la quadrichromie de l’offset, pointillés et rayures de letraset.
Ces années sont aussi marquées par une importante activité politique. Membre du Parti Communiste de 1954 à 1976, il participe à « Peuple et Culture » où il rencontre Pierre Gaudibert, futur directeur du musée d’art moderne de la Ville de Paris. En mai 1968, il participe à « l’Atelier Populaire » de l’école des Beaux-Arts. Il s’investit dans les débats idéologiques du Salon de la Jeune Peinture, où il expose en 1969 dans la « salle rouge pour le Vietnam ».
La même année, Cueco créé la coopérative des Malassis avec Fleury, Latil, Parré, Tisserand.
Ils réalisent collectivement jusqu’en 1979 de grandes oeuvres autour d’évènements polémiques.
Ils exposent notamment {Qui tue ?}, une cinquantaine de peintures autour de l’affaire Gabrielle Russier à l’ARC en 1970 ; {Le Grand Méchoui} (1972), destiné à l’exposition 72/72 : {Douze ans d’art contemporain en France} (1960 – 1972) mais décroché le jour du vernissage en signe de protestation contre la présence policière au Grand Palais ; la peinture murale à Grenoble Sept variations sur le thème du « Radeau de la Méduse ».
La série {Les Hommes rouges} présentée à l’ARC en 1970 l’occupe dix ans, de 1965 à 1975. Elle met en scène des silhouettes dépersonnalisées perdues dans des architectures angoissantes et
démesurées. Cueco mène alors une réflexion sur la sérialité et la trame, qui occupe le fond de la toile et finit par en devenir le sujet principal, que ce soit celle constituée par les bâtiments, les claustras, ou les champs d’herbe. Les animaux occupent une place de plus en plus importante dans ses toiles à partir de 1968. Il montre en 1972 à la Galerie 3 Laplace {Les Chiens}, paysages noirs parcourus par des troupeaux errants, inversant le thème du rapport de l’homme à la nature (l’animal dans la ville). Ce sont {Les Grilles}, {Les Claustras} derrière lesquels se dissimulent les meutes ou encore {L’Inachèvement}, trois séries présentées à la maison de la culture de Bourges en 1975.
1976 est une année de rupture. Il se retire dans son jardin en Corrèze, dessine à nouveau d’après le motif, en particulier l’herbe qu’il voit devant son atelier (série {Herbes/Paysages}, 1977-1987).
Son travail prend un nouvel essor au début des années quatre-vingts. Il réalise de nombreuses fresques à la suite de commandes publiques (les Halles, Paris, 1979 ; théâtre municipal de Limoges en 1982 ; les quais de la Gare d’Orsay à Paris en 1987 ; la salle de réunion « Albert
Londres » au ministère de la Culture, 1990). Ce travail de grand format se développe aussi au théâtre, avec la réalisation des décors d’une vingtaine de pièces.
Il voyage au Japon en 1984 et en Chine en 1986. Il aborde l’Afrique, d’abord à travers des photos qui l’émeuvent (série {Hommes d’Afrique} 1987-1988), avant de se rendre sur place ({Sols d’Afrique}, 1989-1992).
En 1996, passionné par les conditions de l’avènement de l’image, il mène une relecture des chefs-d’oeuvre de Philippe de Champaigne et de Poussin. Durant les années 2000, il entreprend une série d’autoportraits.
Il consigne ses réflexions sur l’art dans plusieurs ouvrages :{L’Arène de l’art} , rédigé en collaboration avec Pierre Gaudibert (1988) est une critique d’un minimalisme et d’un art conceptuel devenus académiques ; son {Journal d’une pomme de terre} réunit ses réflexions d’atelier.
Collectionneur dans l’âme, il dresse des inventaires dans {Le Collectionneur de collections} (1995). Il intervient régulièrement avec verve et humour à la radio, dans les émissions de France Culture {Les Décraqués} (à partir de 1984) et {Les Papous dans la tête} (à partir de 1981). Il est l’auteur de romans comme {Dialogue avec mon jardinier} (2000).
Equipo Crónica
Rafael Solbès (1940–1981)
Manolo Valdès : 1942. Vit et travaille à New York.
Equipo Crónica est né en novembre 1964 de rencontres entre trois artistes espagnols : Manolo Valdès, Rafael Solbès et Joan A. Toledo (qui quitte le groupe en 1965). Associés au critique d’art Tomas Llorens, ils réalisent ensemble l’exposition « Emigration du travail » à l’Athénée commercial de Valence (Espagne).
Sur l’invitation d’Arroyo, ils montrent collectivement des oeuvres peintes individuellement au seizième Salon de la Jeune Peinture en 1965. En 1966 se tient la première exposition individuelle du groupe, en Italie à Reggio di Emilia puis Ferrare.
L’équipe prend part aux grands évènements de la Nouvelle figuration ({Bande dessinée et Figuration narrative} en 1965, {Le Monde en question} en 1967) et expose parallèlement en Espagne à Valence, Madrid, Barcelone en 1966-67. Les peintures de ce tandem d'artistes, volontairement étrangères à toute gestualité ou subjectivité, sont faites de reprises d’images des médias et de chefs-d’oeuvre de la peinture européenne, plus particulièrement espagnole. Elles mêlent des icônes de l’art moderne ou de la peinture espagnole classique avec des espaces kitsch contemporains et des détails incongrus. Exploitant le choc visuel provoqué par le collage, Equipo Crónica peint des grands formats au rendu photographique sans relief, dans un style publicitaire, cherchant l’anonymat derrière un nom de groupe. Les couleurs vives employées sont une réponse à la grisaille artistique durant l’Espagne franquiste. Les aplats de couleur vive et sans nuance, l’absence d’une narration trop évidente déstabilisent le spectateur. La figuration froide de leur peinture est contrebalancée par l’humour et « la distanciation de la distanciation » (pour reprendre le titre d'une exposition consacrée au groupe à Saint-Etienne).
Tous les sujets sont abordés : le système capitaliste, la guerre au Vietnam, la société de consommation. Leurs critiques portent sur la répression du pouvoir policier, le poids de l’histoire de l’art, à travers une réflexion sur la valeur de l’image, sa codification et la
transformation de chefs-d’oeuvre en clichés.
Leur production se décline en séries. Dans une des premières, {La Récupération} (1967-1969), les images sont liées entre elles par un propos : les peintres tentent de récupérer, d’installer dans un espace contemporain les grandes figures de l’art espagnol.
En 1969, ils systématisent leurs manipulations en les appliquant à une seule oeuvre, {Guernica}. Ils déconstruisent ce tableau célèbre pour mieux en montrer les éléments symboliques et les ressorts narratifs. La série est montrée à la galerie Grises à Bilbao et dans l’exposition
{Kunst und Politik} à Wuppertal, Karlsruhe et Cologne en Allemagne.
La série {Autopsie d’un métier} (1969-1970) est présentée à la galerie Val i 30 à Valence.
Les artistes jouent sur les conventions de la peinture (perspective, clair-obscur, trompe l’oeil, touche) à partir d’oeuvres de Vélasquez et sur les oppositions, comme artiste/spectateur ou haute/basse culture.
{Police et Culture} mêle en 1971 l’architecture antique, l’art moderne et la police. Le poids du passé s’assimile au poids du pouvoir répressif.
Lors des {Rencontres internationales de Pampelune} en 1972 (mêlant concerts, performances et vidéos), ils disposent dans les espaces une centaine de silhouettes découpées dans du bois, suscitant une réflexion sur le statut du visiteur à la fois spectateur et regardé.
La {Série noire} de 1972 investit le genre cinématographique, à travers des scènes de films policier, mêlant violence, action et art moderne. A la Biennale de Paris en 1973, ils présentent {L’Affiche}, qui associe images de propagande et images de la modernité artistique, en réaction à la domination étouffante des avant-gardes conceptuelles.
En 1974 se tiennent les premières rétrospectives du groupe, à Rotterdam puis à l’ARC, à Paris.
Les choix pour l’exposition du Pavillon central de la Biennale de Venise, en grande partie conçue par Equipo Crónica, intitulée {Avant-garde espagnole et réalité sociale}, 1936-1976, suscitent une vive polémique en Espagne et en Italie. La lisibilité des séries est de plus en plus complexe. Dans {Billards} (1976-1978) le tapis, les boules et la salle de jeu se transforment en peintures d’avant-garde. La touche du pinceau devient plus visible à partir de 1978 dans les séries {Une sorte de parabole}, {Les Voyages} (1979-1980) ou encore {Chroniques de transition} (1980-1981). La disparition de Rafael Solbès en novembre 1981 met fin à l’équipe, Manolo Valdés continuant seul sa carrière.
Erró
1932, Islande. Vit et travaille à Paris et en Thaïlande.
Erró, de son vrai nom Gudmundur Gudmundsson, naît à Ólafsvík en Islande le 19 juillet 1932. Il vit et travaille aujourd’hui à Paris, Bangkok et Formentera (Espagne). Ses peintures proliférantes offrent un regard critique sur la société de consommation et les systèmes d’oppression à travers le monde. Ses compositions, saturées d’images issues de répertoires visuels divers, jouent sur les contrastes marqués des styles et des couleurs vives, l’accumulation, l’absence de structuration, déclenchant un choc visuel. Les rencontres les plus inconcevables semblent naturelles dans ses toiles.
Il étudie la gravure, la fresque et la peinture aux Beaux-Arts de Reykjavik (1949-1951), puis à l’Académie d’arts d’Oslo en Norvège (1952). Il apprend ensuite la mosaïque à Ravenne. A Florence en 1955, il reprend l’atelier de son ami Fernando Botero, dans lequel il peint de
grands formats. Sa première exposition personnelle, sous le nom de Ferró, se tient à la Galleria Montenapoleone de Milan en 1956. Alain Jouffroy, Matta et Jean-Jacques Lebel deviennent ses amis. En 1958, il s’installe à Paris où il rencontre André Breton et les artistes surréalistes qui l’initient au collage. Il multiplie les assemblages d’images récupérées. Il transpose ensuite ces maquettes sur la toile, à main levée, puis à l’épiscope, procédant par séries.
En 1961, il participe pour la première fois au Salon de mai et à la Biennale de Paris. Il puise son inspiration dans l’univers des sciences et techniques, comme dans la série {Les Usines} (1959-1962) ; il publie les manifestes {Mecanismo et Mecanismo n°2} en 1962 et 1963. Il expose alors en Italie, France, Belgique. Ses séries mettent en scène avec une cruelle ironie les aberrations de la société de consommation, de la culture de masse. Il exploite l’iconographie la culture populaire : bandes dessinées, photos de presse, catalogues de vente, images de propagande, portraits de stars et de dirigeants, chefs-d’oeuvre de la peinture occidentale, clichés de l’exotisme.
En 1963, il se rend à New York, sillonne les supermarchés et fast-foods. Il côtoie les artistes du Pop Art, Rauschenberg, Rosenquist, Oldenburg ou Warhol. La galerie Gertrude Stein lui consacre en 1964 une exposition personnelle à New York, événement rare à cette époque pour un artiste installé en France.
Jusqu’en 1965, il réalise ou joue dans de nombreux films expérimentaux. Il organise des performances, notamment avec Jean-Jacques Lebel ; le happening {Gold Water} est dirigé contre le
gouvernement américain engagé dans la guerre du Vietnam. La critique des pouvoirs impérialistes et des dictatures dans le monde à travers une dérision faite de rapprochements acides occupe une part grandissante de son travail à partir des années soixante-dix.
Son travail, fondé sur la réutilisation jubilatoire et provocante d’images l’amène à participer à l’exposition {La Figuration narrative dans l’art contemporain} (1965).
Voyageur infatigable, il collecte des images en URSS (1965, 1968), à Cuba (1967), New-York, Berlin (1970) et fait un tour du monde durant neuf mois (1971). A l’initiative de Wilfredo Lam, il exécute avec 80 autres artistes un spectaculaire {Mural} à la Havane en 1967. La réalisation de peintures murales lui permet d’insérer visiblement son travail dans la société, à Angoulême (1982), à la Mairie de Lille (1988), à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris (1990) ou à la station de métro Oriente de Lisbonne (1998).
A partir de 1972, les expositions et rétrospectives se succèdent à travers le monde, à Reykjavik, au Japon, à la Biennale de Venise, au Jeu de Paume à Paris en 1999. Il affine ses compositions et ses enchevêtrements au fil des années, tout en restant fidèle au style mis en place au début des années soixante. En 2001, la Collection Erró du musée de la Ville de Reykjavík est présentée au public dans son nouveau cadre à Hafnbarhúsid.
Öyvind Fahlström
1928, Sao Paulo (Brésil) - 1976, Stockholm (Suède).
D’origine norvégienne et suédoise, Öyvind Fahlström passe ses premières années à Sao Paulo et à Rio de Janeiro. Au début des années 1950, il étudie l’histoire de l’art et l’archéologie à l’université de Stockholm et mène simultanément plusieurs activités : théâtre, poésie (son {Manifeste de poésie concrète} est publié en 1953), journalisme et critique d’art. C’est de la coexistence de ces différentes activités que vont naître la singularité et la force de sa démarche artistique. Les poèmes sonores et visuels qu’il réalise dans les années 1950
témoignent d’une influence surréaliste dont il a complètement assimilé les techniques automatiques.
Sa première exposition personnelle a lieu à la galerie Numéro à Florence en 1953. A Paris en 1956, il participe à l’exposition « Phases ». Deux ans plus tard, Daniel Cordier devient son marchand. En 1961, il décide de s’installer à New York où il se lie d’amitié avec, notamment,
Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Claes Oldenburg, Jasper Johns et Robert Morris. Il partage désormais sa vie entre les Etats-Unis et l’Europe, plus précisément Stockholm, Paris et Rome.
Dès lors, il va incorporer dans son travail des sources aussi disparates que la bande dessinée, les produits des mass-media (publicités, informations), des références scientifiques ou littéraires (à la science-fiction, à William S. Burroughs …), des données statistiques,
économiques ou géopolitiques, dans une logique qui tranche avec le formalisme Pop alors en vigueur. Ces éléments deviennent le matériau de ses peintures dans lesquelles mots et images renvoient les uns aux autres. Il existe de fait un rapport étroit entre ses activités d’écriture et son travail d’artiste.
En 1962, il présente à la galerie Sydney Janis {Sitting…Six Months Later}, première peinture « variable ». A la différence des montages qui précédent où une même forme pouvait resurgir peinte en plusieurs emplacements dans le même espace, les peintures « variables » présentent des figures mobiles découpées et aimantées, issues de l’imaginaire des bandes dessinées, qui sont positionnées dans l’espace du tableau au gré du spectateur. Thème qui va occuper le reste de sa vie, le principe de variation de ces éléments, parce qu’interchangeables, donne une mobilité permanente à l’image. Dans l’esprit de Fahlström, ce qui est central dans une oeuvre d’art ne sont ni les qualités compositionnelles ou stylistiques mais la manipulation, la stratégie et le jeu. Pour lui, l’absence d’ordre n’est que l’écho du désordre organique et moral du monde.
Les années qui suivent voient alors une intense activité littéraire et cinématographique. Il élargit encore ainsi son champ d’intervention en réalisant aussi bien des happenings, des romans sonores, des collages radiophoniques que des films ou des peintures à l’huile sur photographie. Après avoir publié Aide-mémoire pour {La dernière mission du Docteur Schweitzer} (1964) et diffusé sous forme de collage radiophonique {Oiseaux de Suède} (1964), Fahlström réalise, entre autres, un documentaire en noir et blanc pour la télévision suédoise sur les mouvements pacifistes puis exécute, toujours en 1967, ses premières oeuvres dont les éléments peints flottent sur l’eau ({Parkland Memorial}). Il réalise en 1968 un film 35 mm sur les enfants des pays sous développés ({U-Barn}) et ne cesse, sa notoriété grandissant, de prendre parti face aux misères du monde.
En 1966, il réalise en sérigraphie les premiers multiples variables puis, en 1970 et 1971, la série des neuf peintures-jeux de {Monopoly}, une adaptation politique du jeu de société, composée d’éléments qui s’adaptent grâce au magnétisme sur un tableau métallique. Au-delà de
son apparence de jeu joyeusement coloré, cet ensemble met en cause avec férocité les mécanismes financiers, politiques et sociaux qui régissent la société américaine et, plus largement, les relations entre les états. Les oeuvres et les écrits de l’artiste sont animés de la conviction que l’art est une force suffisamment puissante pour changer la conscience de l’individu et, en conséquence, la société. Aussi Fahlström n’a-t-il de cesse, au fil de ses écrits et de ses oeuvres, de relier sa pratique artistique et ses commentaires critiques à la réalité politique de son temps.
Gérard Fromanger
1939, Pontchartrain (France). Vit et travaille à Paris et à Sienne.
Alors qu’il participe très tôt aux activités du salon de la Jeune Peinture, qui s’ouvre dès 1965 aux secousses de l’actualité et aux engagements politiques, Gérard Fromanger prend le parti, à partir de 1968, d’une peinture en prise directe avec l’histoire de son temps et le réel le plus prégnant qui l’anime. Il fréquente un milieu d’intellectuels de gauche, de
Jacques Prévert, Alain Jouffroy à Michel Foucault, de Gilles Deleuze à Félix Guattari, qui contribue à l’affirmation de son art. Ses toiles s’organisent en cycles, suites de compositions liées entre elles, autant stylistiquement que thématiquement, où il use tour à tour des moyens d’agencement les plus variés : superpositions de plans, surimpressions,
montages d’éléments figuratifs hétérogènes ou répétitifs, silhouettes détourées. La couleur, qui donne souvent lieu à des jeux complexes, occupe une place essentielle. Ainsi, dans la série {Boulevard des Italiens} conçue à partir de prises de vue réalisées sur les grands boulevards parisiens et présentée en 1971 à l’ARC/Musée d’art moderne de la ville de Paris, les silhouettes des passants se détachent du décor urbain par un rouge flamboyant.
Fromanger utilise le document photographique comme motif standardisé de la modernité. Dans la préface d’un catalogue d’exposition consacré à l’artiste ({La peinture photogénique}, 1975),
Michel Foucault analyse très justement la méthode du peintre.
Fromanger peint à partir d’une photographie projetée par un épiscope sur la toile, devenue écran, tandis que l’agencement des couleurs vient « créer un événement-tableau sur l’événement-photo » (Michel Foucault). À partir de 1978, l’artiste choisit de peindre directement sur la toile, sans projection d’image photographique, avec la série la plus vaste et la plus ambitieuse réalisée jusqu’ici, {Tout est allumé}. Les couleurs monochromes contenues précédemment dans des silhouettes commencent à s’émanciper de leur cadre. Ces 46 toiles, présentées dans une rétrospective au Centre Pompidou en 1980, constituent une synthèse des recherches précédentes et un tournant dans la carrière
de l’artiste. Le peintre utilise comme point de départ une multiplicité de motifs et de sources: schémas, panneaux signalétiques, signaux, cartes, les cinq sens d’après les tapisseries de La Dame à la Licorne… Tous les tableaux sont liés par une seule phrase, fragmentée tableau par tableau, comme un poème éclaté.
À partir des années 1980, renouvelant sans cesse son univers formel, Fromanger inaugure un nouveau chapitre de son oeuvre et de sa vie : il quitte Paris et s’installe à Sienne.
Délaissant un moment l’agitation urbaine, il découvre les paysages de Toscane, les primitifs siennois et la civilisation étrusque revisités par le regard du peintre dans les séries {Lüftmalereï} [Peintures de l’air] (1980-1981), {Allegro} (1982-1983) et {Le palais de la découverte} (1983). Dans {La vie quotidienne : trente instantanés} (1984), une suite qui ne constitue qu’un seul tableau, les silhouettes rouges sont devenues des « corps-couleurs » enchevêtrés - acrobates, danseurs à la nudité abstraite – qui déambulent sur des fils, traces d’un pinceau qui court sur toute la toile. Avec la série {Quadrichromie} qui couvre la majeure partie des années 1990, la figure est à nouveau engagée dans un processus de décomposition où se retrouve l’une des conjugaisons favorites de sa peinture : les « fils-couleurs ». De décomposition en recomposition, Fromanger, proche des préoccupations de Deleuze et Guattari, réalise les séries {Rhizomes pastels-café} (1997-1999) et {Rhizomes peintures-café} (2000), où il immobilise dans des taches de café un bestiaire familier puis des personnages qui surgissent d’un réseau inextricable de lignes colorées en forme de coulures.
Dans la continuité de ses propositions picturales antérieures, la série récente {Sens dessus dessous} (2004), tableaux réversibles composés de silhouettes-couleurs en aplat sur un fond noir saisies dans un mouvement, réalisent la symbiose entre le passant solitaire et la foule.
À travers un souci constant de recommencement, de remise en question et d’invention, les recherches de Fromanger interrogent inlassablement les moyens et les procédés de la représentation et font de la peinture un processus critique pour repenser l’image.
Peter Klasen
1935, Lübeck (Allemagne). Vit et travaille à Vincennes et à Berlin.
En 1959, après des études à l’Ecole des Beaux-Arts de Berlin, Peter Klasen quitte définitivement l’Allemagne pour s’installer à Paris. En 1961 apparaît pour la première fois dans sa peinture l’image morcelée du corps féminin qui va demeurer une constante dans son travail jusqu’en 1973. Peintes à l’aérographe au travers de caches prédécoupés, ces oeuvres à la précision chirurgicale juxtaposent des fragments d’objets et de corps sur un fond généralement divisé en deux ou trois zones de couleurs distinctes. Entre 1967 et 1972, la dualité femme/objet est omniprésente. L’ARC/Musée d’art moderne de la ville de Paris présente
en 1971 la première exposition personnelle de l’artiste dans un musée. Cette rétrospective met en évidence sa fascination pour l’érotisme associé à des représentations d’objets usuels - mécaniques, sanitaires ou hospitaliers – qui puisent dans le monde des médias contemporains
(films, publicités, revues médicales, etc). La photographie sert très souvent de point de départ aux oeuvres de Klasen, qu’il les découpe dans des journaux ou qu’il réalise lui-même la prise de vue. Klasen introduit également, sous forme de collages, des objets réels dans la
peinture : thermomètres, fourchettes, poignées… La pratique du montage et du gros plan, les jeux de lumière, l’usage fréquent du noir et blanc font référence au cinéma, auquel Klasen voue une véritable fascination, tout comme nombre de peintres de cette génération pour qui la modernité se découvre moins dans les galeries que dans les salles obscures.
A partir de 1973-74, la représentation du corps humain disparaît pour un temps, occultée par de lourdes portes, grilles, bâches, provenant de camions, de wagons ou de prisons, autant d’éléments qui enferment, isolent et oppressent. Cet univers carcéral, d’abord aseptisé et en
grisaille, verra ensuite sa thématique évoluer vers des couleurs plus diversifiées et une signalétique de plus en plus présente, avec de nombreuses inscriptions en formes d’avertissements inquiétants (« Corrrosif », « Poison », « Acide sulfurique », « Douche de sécurité »…).
C’est au cours de son premier voyage à New York en 1981 que Klasen effectue de nombreuses photographies, notamment de graffitis, sujet qui amorce la série des {Traces} où des taches, des inscriptions, des marques de craie et autres salissures viennent perturber les surfaces régulières et lisses. Témoignages de l’intérêt que l’artiste a toujours porté à Kurt Schwitters, les collages d’objets et de matériaux les plus divers (carton, bois, ficelle, plastique) se multiplient au milieu des années 1980 aussi bien sur des toiles de grandes dimensions que sur des formats d’études qu’il appelle ses « gouaches ». Mélangés au répertoire pictural déjà connu (représentation de poignées, gonds, écrous, lettres, chiffres…), ces collages en relief ouvrent une nouvelle dimension dans l’oeuvre vers l’espace et le volume qui va caractériser désormais les recherches de l’artiste dans les années 1990.
Ainsi, en 1991, à la Fiac (Galerie Louis Carré), il expose une énorme installation-déambulatoire inspirée du film de Samuel Fuller {Shock Corridor} (1963) qui mêle d’immenses peintures à des objets réels
(baignoires, lavabos, appareillages électriques…). Plus tard, il utilise même des matériaux inhabituels comme support - plaque d’acier ou ciment - qui se substitue à la toile. Cette volonté d’échapper à la surface du tableau et d’investir l’espace s’amplifie dans les oeuvres récentes qui, si elles incluent toujours des objets réels (manomètres, échelles, grilles, néons…), le font de façon plus sculpturale qu’auparavant. Délaissant pour un temps les formes usinées accolées à la peinture, Klasen réalise en 1997 de véritables sculptures autonomes en terre chamotée.
Depuis 2000, les oeuvres de Klasen juxtaposent deux documents contrastés en un montage inattendu, accompagnés d’une inscription au néon sur la toile, sorte d’annale énigmatique du XXIe siècle. Tout à la fois familières et inquiétantes, les images de Klasen, nourries de la banalité implacable du quotidien, produisent un effet de tension et un sentiment d’angoisse. Le morcellement de la figuration, le refus d’une représentation ordonnée et stable, l’image d’une féminité stéréotypée et anonyme sont autant de tentatives de désigner l’aliénation et la solitude de l’individu et de saisir le monde dans toute son étrangeté et sa violence.
Jacques Monory
1924/1934, Paris. Vit et travaille à Cachan.
Après dix ans de recherches picturales marquées par des expérimentations de figurations et d’abstractions oniriques, Jacques Monory choisit en 1962 d’orienter sa peinture vers la représentation distanciée de l’univers quotidien. Ses recherches sont alors marquées par l’influence du pop art et de James Rosenquist en particulier. Monory travaille à partir d’images photographiques, souvent prises par lui-même ou découpées dans des magazines. Il utilise un épiscope qui les agrandit à la mesure du tableau, opérant ainsi une sorte de mise
au carreau. A partir de 1966, il entreprend la réalisation de séries thématiques. Ses tableaux, où apparaissent de manière obsessionnelle des voitures et des armes à feu, des animaux, des figures féminines sensuelles, des jardins inquiétants, des bâtiments aseptisés, constituent autant un inventaire des objets et lieux déshumanisés de l’univers moderne qu’un répertoire des fantasmes de l’artiste. A partir de 1967, la toile est préalablement recouverte d’une couleur monochrome (le plus souvent bleue, parfois lilas ou jaune), qui renforce
l’atmosphère de rêve et de suspens et la contradiction entre impression de réalité et sentiment de basculement du réel.
La série des vingt-deux {Meurtres}, commencée en 1968, correspond au moment où il tourne son premier film, {Ex-}, qui mêle plusieurs types d’images se succédant en un montage rapide. Un photogramme de ce film va servir de point de départ à l’un des tableaux de la série où le
peintre se représente en meurtrier solitaire quittant les lieux du crime. L’artiste apparaît régulièrement dans ses oeuvres, tour à tour héros, tueur à gages, victime ou simple témoin.
Fasciné par le cinéma (il réalise en 1973 son second court-métrage en 16 mm, {Brighton Belle}), Monory recourt également au cadrage décalé, à la brisure, à la juxtaposition d’images ou à l’insertion dans la composition de miroirs criblés d’impacts de balles, où le spectateur se
trouve comme pris au piège. Présentée en 1971 à l’Arc/Musée d’art moderne de la ville de Paris, la série {Velvet Jungle} (1969) - des toiles de jungle plongées dans un bain bleu - fait écho à la guerre du Vietnam. En 1969, Monory effectue son premier séjour à New York, d’où il rapporte un ensemble considérable de photographies donnant lieu, en 1971, à la série de douze toiles, {New York}.
En 1972, il peint les séries {Mesures}, {Dreamtiger}, des portraits de son fils Antoine et entreprend l’ensemble des {Premiers Numéros du catalogue mondial des images incurables}, présenté au CNAC en 1974, où il dénonce l’ordre établi par une critique de la police, de l’armée, de la violence, de l’enfermement ou des relations entre l’art et l’argent. En 1973, il traverse les Etats-Unis en voiture avec son fils. Ce voyage revêt une importance essentielle car le peintre constitue, à partir de photos, un répertoire de formes et d’images où il va puiser pendant de nombreuses années. A partir de 1977, il abandonne la monochromie
pour une trichromie bleu, jaune, rose ({Technicolor}).
A la fin des années 1970 et au début des années 1980, Monory se livre volontiers à l’écriture ({Diamond Back}, roman policier publié en 1979 chez C. Bourgois) ou illustre des ouvrages ou des livres-objets : {Eternité, zone tropicale} (1976) d’Alain Jouffroy, {Récits tremblants} (1977), avec Jean-François Lyotard, {Rien ne bouge assez vite au bord de la mort} (1984) cosigné avec Daniel Pommereulle. Jusqu’en 1980, avec la série {Ciel}, la représentation de nébuleuses et de galaxies devient son unique thème jusqu’à {Ciel n°39}, une carte générale du ciel, la dernière de la série qui clôt, en 2005, l’exposition que lui consacre le MacVal à Vitry-sur-Seine. Les constellations sont de retour en 1986, Monory composant une grande installation de peintures de cosmos pour l’ouverture du Planétarium de la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.
En 1982, Monory entreprend la série des 32 {Toxique} qui seront exposés en 1984 à l’ARC/Musée d’art moderne de le ville de Paris puis en 1986 à la Biennale de Venise. Depuis le milieu des années 1980, l’oeuvre de Monory se poursuit avec de nombreuses séries, en particulier {Tanatorolls} (1986-87), {Métacrime} (1989-90), {Les éléments du désastre} (1993-94), où revient le thème de la mort, puis {Baisers} (2000-2002), consacrée aux baisers de cinéma, ou récemment {Vitrines} (2003), inspirée de photographies de vitrines de magasins. Tel un photogramme « gelé » où se mêlent dimensions réelles et fictives, la peinture permet à Monory de condenser le temps et de concilier en un même lieu des espaces hétérogènes.
En savoir plus sur Jacques Monory
Bernard Rancillac
1931, Paris. Vit et travaille à Malakoff.
Après une période abstraite, à la fin des années 1950, au cours de laquelle, influencé par Tapies et de Staël, il expérimente divers techniques et supports, Bernard Rancillac réintroduit figures et couleurs dans ses peintures. Il entreprend, en 1962, une série d’oeuvres
matiéristes dans lesquelles apparaissent des éléments figuratifs allusifs, inspirés du personnage de Fantômas. Le retour à la couleur, qui va de pair avec la mise au point d’un répertoire figuratif débridé, riche en allusions érotiques, se manifeste d’abord dans des séries de dessins au graphisme spontané puis dans des toiles aux amples effusions colorées
({L’écume rouge}, 1963). En 1964, avec les peintres Hervé Télémaque et Peter Foldès et le critique Gérald Gassiot-Talabot, il organise l’exposition {Mythologies quotidiennes} au Musée d’art moderne de la ville de Paris, où il présente, notamment, {Le retour de Mickey}.
En 1965, son exposition à la galerie Mathias Fels est marquée par la présence dans ses oeuvres d’une figuration de plus en plus explicite, inspirée par l’univers des dessins animés et organisée selon les principes narratifs de la bande dessinée.
En même temps qu’il adopte la peinture acrylique qui donne à la représentation un effet figé et glacé, Rancillac commence en 1965-66 à recourir à l’épiscope pour reporter des images de magazines, de films ou de la télévision sur la toile. Il utilise cette nouvelle technique pour des sujets inspirés par l’actualité politique. En 1967, il participe à l’exposition {Le monde en question} à l’Arc/Musée d’art moderne de la ville de Paris, puis, la même année, il présente à la galerie Blumenthal-Mommaton une série de dix-huit toiles exécutées à partir de photographies illustrant les événements qu’il juge les plus marquants de l’année 1966 : guerre du Vietnam, révolution culturelle en Chine, affaire Ben Barka, apartheid en Afrique du Sud, lutte pour la contraception, conflit entre Israël et les pays arabes, etc… Pour le catalogue de cette exposition, Rancillac demande à Pierre Bourdieu de rédiger la préface. A partir de 1968, Rancillac s’engage au côté de l’extrême gauche. Actif au sein de l’Atelier populaire de l’Ecole des Beaux-Arts, il réalise plusieurs affiches dont la célèbre {Nous sommes tous des juifs et des allemands} qui présente le portrait rieur et triomphant de Daniel Cohn-Bendit.
Les tensions internationales, les crises politiques et les guerres le conduisent à radicaliser son propos dans des oeuvres dont le contenu social et politique est de plus en plus affirmé. En 1971 dans l’exposition {Le Vent}, au Centre national d’art contemporain, Rancillac présente la
plupart des toiles engagées réalisées au cours des deux dernières années. L’accrochage de l’exposition est crucial : la Chine y est confrontée aux Etats-Unis. Rancillac réserve également une place importante au conflit israélo-palestinien : le grand triptyque {Israël et
ses juges} est exposé près d’une peinture-slogan en arabe : {Vive la révolution palestinienne}.
Au cours des années 1970, Rancillac prend peu à peu ses distances avec le militantisme radical. En témoigne l’évolution de son iconographie, où apparaît, en 1972, la musique avec la série {Jazz}. Jusqu’aux années 1980, il peint le jazz sous toutes ses formes, se tournant vers le reggae en 1982.
Vers 1976-77, en contrepoint des oeuvres inspirées par le jazz, il renoue avec des sujets engagés (Belfast, Front Polisario …) et il exécute en 1978 une suite de treize panneaux évoquant la mort, en prison, de la militante de la Fraction Armée Rouge, {A la mémoire d’Ulrike Meinhof}. Au début des années 1980, il entreprend la série des {Images éclatées}, remettant en question la notion traditionnelle de format et de cohésion du sujet. Ces oeuvres évoluent vers des pièces de très grande dimension qui prennent la forme de véritables installations ({Kiss}, 1983, {Motocross}, 1984). En 1985, il commence la série {Cinémonde}, 25 toiles inspirées des couvertures de magazines retouchées où il représente des stars du cinéma : Vivien Leigh, Rita Hayworth, Jean Harlow, Michèle Morgan, etc. En 1998-99, la situation politique et la répétition des massacres en Algérie lui inspirent une série qu’il expose sous le titre {Algérie}. En 2000-2002, il exécute la série {Femmes}, des nus peints à partir de photos prises par lui-même. Il n’en continue pas moins à traiter des sujets inspirés par les guerres survenues en Tchétchénie ou en Afghanistan.
En savoir plus sur Bernard Rancillac
Antonio Recalcati
1938, Bresso (Italie). Vit et travaille à Milan.
Après une production de jeunesse proche de l’expressionnisme abstrait, Antonio Recalcati, autodidacte, réalise de 1960 à 1962 un ensemble de plus d’une centaine de tableaux obtenus par l'impression de son corps et de ses vêtements directement sur des toiles recouvertes de peinture noire ou terre de Sienne ({Les Empreintes}). Il s’installe à Paris en 1963 et rejoint le Salon de la jeune peinture où il se lie d’amitié avec Eduardo Arroyo et Gille Aillaud.
En 1964, ils réalisent ensemble une suite de treize toiles inspirées d’une nouvelle de Balzac racontant les amours d’un soldat de Bonaparte avec une panthère pendant la campagne d’Egypte ({Une passion dans le désert}). Au-delà du sujet, éminemment narratif et qui rompt avec l’abstraction et le pop alors dominants, c’est la volonté d’oeuvrer collectivement et le refus d’une facture personnelle qui importent aux trois artistes. L’année suivante, les trois complices exécutent huit toiles intitulées {Vivre et laisser mourir, ou la fin tragique de Marcel Duchamp} où ils relatent en cinq épisodes l’assassinat de Marcel Duchamp.
Présentée la même année dans l’exposition {La Figuration narrative dans l’art contemporain} à la galerie Creuze, la série fait scandale.
Mêlant depuis 1963 ses empreintes à des paysages parfois barrés d’une croix, évocations de Paris ou de New York, il est touché par les événements de mai 1968 et retourne à Milan en 1969 préparer sa série autobiographique intitulée {1962-1972}, où il évoque les sept années passées et imagine les trois années à venir.
Un voyage à New York en 1970 lui donne l’idée de la série {Intérieur américain}, exposée en 1972 à l’ARC/Musée d’art moderne de la ville de Paris pour sa première exposition monographique dans un musée et qui inspire à Jacques Prévert un texte-poème pour le catalogue. En 1973,
Recalcati expose à la galerie Mathias Fels une série de toiles, {La bohème de Chirico}, où il revisite les oeuvres de la période métaphysique de Giorgio De Chirico sur un mode ironique, en y introduisant de nombreux produits alimentaires – spaghetti, salami et tête de veau.
Répondant à la proposition d’Alain Jouffroy de rendre hommage à François Topino Lebrun - seul peintre de l’époque révolutionnaire guillotiné sur l’ordre de Bonaparte en 1801-, Recalcati accomplit un ensemble de toiles présentées au Centre Pompidou en 1977 dans
l’exposition {Guillotine et peinture, Topino Lebrun et ses amis}, où le chevalet est identifié à la guillotine. La même année, il expose à la deuxième édition des {Mythologies quotidiennes} au Musée d’art moderne de la ville de Paris puis, en 1978, il participe à la 37ème Biennale de
Venise.
En 1979, Recalcati présente à l’ARC/Musée d’art moderne de la ville de Paris un ensemble de toiles de grand format sur le thème des saisons où sont réunies des images a priori sans relation : des paysages très colorés, un ensemble représentant la figure du peintre, un autre figurant un pinceau émergeant d’une déchirure de la toile, exhibé, brandi puis brisé, motif privilégié qui domine de sa présence cette série de tableaux.
En 1980, Recalcati s’installe à New York où il vit jusqu’en 1985. Il exécute une série de cinquante-trois toiles intitulée {Third Street at Sixth Avenue} qu’il consacre à des joueurs de basket sur des aires de jeu : se succèdent marquages au sol, grillages, paniers de basket, le corps des joueurs ou leur ombre. De retour en Italie en 1986, le Palazzo Reale à Milan puis le Palazzo Braschi à Rome organisent une importante rétrospective de son travail. Recalcati se lance dans la sculpture puis dans la production de céramiques qu’il expose à la galerie de France en 1991 sous le titre {Terra Cotta}, puis au Musée Ludwig à Cologne et au Musée Sprengel à Hanovre. A partir de 1996, il revient à la peinture avec des paysages réalisés à Essaouira ({Le port d’Essaouira}, 1996). Il aborde ensuite le thème de la mort avec des nus associés au mythe de Charon ({Le livre de Charon, Le Naufrage de Charon}, 1999) puis réalise un ensemble de peintures sur la musique à partir de 2003 ({Le violon rouge d’Hortobagy, Il violinista cieco}, 2003, {La nuit Tzigane}, 2004).
Peter Saul
1934, San Francisco (Etats-Unis). Vit et travaille à Georgetown (Etats-Unis).
D’origine américaine, Peter Saul séjourne en Europe – Pays Bas, Angleterre, France, Italie – de 1956 à 1964. N’appartenant ni à l’expressionnisme abstrait ni au Pop Art, l’oeuvre de ce californien expatrié se révèle d’emblée inclassable. Formé à l’école du surréalisme abstrait d’Arshile Gorky, l’artiste invente son propre langage, à partir de l’esthétique de la bande dessinée, des graffitis et des magazines populaires. Manifestant un mépris délibéré pour la mesure et le « bon goût », il transforme ces emprunts en leur infligeant des distorsions
associés à un style volontairement sommaire et bâclé où abondent bavures et giclures. Il réalise alors une peinture libérée, véritable délire accumulatif, ponctuée par les onomatopées issues des « comics », et dont les sujets sont volontiers pornographiques ou scatologiques. En
1962, 1963 et 1964, la présentation à Paris des oeuvres de Peter Saul à la galerie Denise Breteau a fortement marqué plusieurs jeunes artistes français – tels que Arroyo, Rancillac ou Télémaque.
En 1964, Saul retrouve San Francisco devenu le foyer de la contestation beatnick et hippy, contestation dont il adopte les thèmes dans sa peinture qui devient une véritable arme politique : dénonciation de la guerre du Vietnam, du racisme, du confort de la société de
consommation, de la condition féminine. Les tableaux politiques de Saul, réalisés de 1965 à 1972, figurent parmi les plus violents qu’il ait réalisés. Le retour de l’artiste en Californie s’accompagne d’une radicalisation de sa peinture qui se traduit, dans son style, par une mutation sensible. Il choisit d’adopter une facture plus nette, moins expressionniste, permettant de mieux saisir la manière dont les figures habitent l’étendue de la toile. Il abandonne la peinture à l’huile, tandis que les éclaboussures et les jeux de matière de la période européenne disparaissent pour laisser place aux couleurs transparentes, fluorescentes, acides, volontiers déplaisantes, de l’acrylique. La composition est elle aussi régie par des principes nouveaux : abandon de la dispersion et du discontinu pour l’instauration, à l’intérieur de la toile, d’un parcours, d’un enchaînement labyrinthique de formes molles
étirées en appendices monstrueux, gonflées comme des baudruches, qui deviennent l’une des marques distinctives de l’art de Peter Saul. Sa vision du monde de l’art est désabusée et moqueuse comme en témoignent les {World Art Portraits}, présentés à Chicago en 1972.
Cherchant à démonter les mécanismes de l’avant-garde, il réalise une sorte de jeu des sept familles avec des dessins satiriques de critiques, marchands, conservateurs, artistes, transformant Andy Warhol, Frank Stella ou Clement Greenberg en monstres de l’histoire naturelle. A partir de 1973, bousculant une fois de plus toutes les conventions, Saul met de côté la dimension politique de son travail au profit de citations de chefs-d’oeuvre de l’histoire de la peinture (Rembrandt, Delacroix, Picasso, de Kooning, Dali…). Au cours des années 1980, Saul donne à ses compositions une plus grande ampleur. De grandes dimensions, ses oeuvres aux couleurs agressives et clinquantes, aux formes impeccables, rondes comme des gouttes, ont une séduction
trompeuse. Elles présentent des scènes d’une violence extrême, entre dérision et horreur indicible. Saul revient à l’huile qu’il applique en éruptions désordonnées et pointillistes sur une composition exécutée à l’acrylique. Depuis les années 1990, il revisite des sujets traditionnels - natures mortes, paysages, portraits – et il poursuit inlassablement la
critique des violences sociales et des événements politiques de son temps. Bill Clinton et Lady Diana sont entrés dans le répertoire du peintre. Avec le temps, la peinture de Saul ne perd rien de sa dimension profanatrice et de sa jovialité féroce. Eternel outsider, il garde intacte sa fureur d’adolescent incendiaire dans laquelle des artistes plus jeunes, tels Mike Kelley, se retrouvent.
Peter Stämpfli
1937, Deisswill (Suisse). Vit et travaille à Paris.
Avant de s’installer à Paris en 1959, Peter Stämpfli étudie en Suisse les arts graphiques et la peinture. Les tableaux réalisés à partir de 1963 donnent à voir des objets du quotidien (lavabo, téléphone, bouteille, cigarettes…) ou des aperçus fragmentaires de gestes simples et
stéréotypés. Le choix des sujets est toujours celui de l’environnement immédiat. Quant à la figure humaine, lorsqu’elle apparaît, le cadrage en fait systématiquement disparaître le visage. Anonymes, ce sont moins des individus qui sont figurés que les gestes qu’ils exécutent : soulever son chapeau ({Bond Street}, 1964), tenir un verre ({Party}, 1964) ou un gant ({Gala}, 1965). S’il a pu être rapproché des artistes du pop art américain, Stämpfli s’affirme par des solutions originales apportées à la question de l’objet et de son image. Traités en gros plans de manière lisse et impersonnelle, selon un cadrage cinématographique, les sujets
inspirés de l’imagerie publicitaire sont isolés de leur contexte par un fond monochrome. Cette relation entre une vision réaliste et une expression abstraite, présente dès ses premiers tableaux, sera le moteur de toute la création ultérieure de l’artiste.
À partir de 1966, son travail prend un tournant décisif par la représentation d’un objet emblématique de la société de consommation, la voiture, qui avait fait son apparition dans l’iconographie de l’artiste en 1963 ({Ma voiture}) et qui devient le thème unique de ses tableaux. Dans un souci constant d’approfondissement et d’élimination, le peintre passe progressivement de la roue, inscrite dans une vision d’ensemble ({Grand Sport}, 1966), à une vision frontale de celle-ci ({Caprice}, 1968) pour réaliser enfin avec {SS 396 n° 2} (1969) une oeuvre qui fait coïncider sa forme avec celle de l’objet représenté. Agrandie à près de 2 m de diamètre, la représentation de cette roue perd sa lecture immédiate pour devenir un ensemble de formes géométrique et symétriques, évoquant la structure des toiles de Kenneth Noland ou des cibles de Jasper Johns. Cette réalisation apparaît comme le point de départ de l’expérimentation dans laquelle Stämpfli est encore aujourd’hui engagé.
En 1971, à la Biennale de Paris, Stämpfli réalise une première tentative de peinture monumentale de 6 m de hauteur ({Royal}). L’apport essentiel de cette oeuvre, conçue en fonction du lieu où elle est présentée, est l’impression d’une trace sérigraphique de 30 m de long,
créant un effet illusionniste de déplacement du pneu. Stämpfli expose à cette occasion ses premiers dessins qui forment un chapitre particulier de l’oeuvre, un terrain de recherches qu’il développe parallèlement à la peinture.
En 1974, Stämpfli ouvre un territoire nouveau avec {Atlas n°2}, présentée au musée Galliera, une toile rectangulaire de 8 m de long dont la surface est parcourue d’un bord à l’autre de lignes parallèles continues. D’une rigoureuse bichromie, {Atlas n°2} inaugure la série des toiles où les problèmes de l’abstraction, bien plus que ceux de la figuration, gouvernent la réalisation du tableau, évoquant dans leur
organisation interne les premières oeuvres de Frank Stella.
En 1979, il entreprend une série de pastels qui présentent, après dix ans de peinture dans des camaïeux de gris, d’ocres ou de bruns, une explosion de couleurs vives et des contrastes francs et audacieux.
Transposée sur toile, l’expérience du pastel va conduire le peintre à une formulation d’apparence totalement abstraite. Les bandes, chevrons et autres éléments sculptés du pneu interprétés en aplats de couleur ne permettent plus désormais la reconstitution de l’image initiale.
Depuis vingt-cinq ans, de nombreuses interventions dans l’espace public donnent à l’oeuvre de Stämpfli une nouvelle dimension : réalisation monumentale pour le mur-pignon d’un immeuble zurichois en 1983, projets pour la façade des magasins Migros en 1984 et pour les vitraux de l’Abbaye des Cordeliers à Châteauroux en 1988, réalisation de 16 panneaux muraux de 120 m de long pour la gare de Fribourg ({Exit}, 1999). En 1985, dans la continuité de ses recherches picturales, il réalise sa première oeuvre tridimensionnelle {Empreinte de pneu S 155}, une trace en creux de 30 m de longueur installée dans un parc du Val-de-Marne. Ce jeu sur l’agrandissement est aussi à la base du relief en acier chromé {Communication} (1990). Que ce soit par la fragmentation, par la découpe du tableau, par la fabrication de traces ou l’agrandissement démesuré, Stämpfli se livre à un questionnement et à une mise à l’épreuve sans cesse réitérés des moyens de la représentation.
Hervé Télémaque
1937, à Port-au-Prince (Haïti). Vit et travaille à Villejuif.
Désireux d’entreprendre une carrière de peintre, il fait ses études d’art dans l’atelier de Julian Levi à l’{Art Students’ League} de New York de 1957 à 1960. Il y découvre Gorky et l’Expressionnisme abstrait. Quittant New York à cause du racisme ambiant, il arrive à Paris en
1961. Après une année de travail intense dans des conditions matérielles difficiles, il participe au premier Salon Latino-américain de Paris. Il reçoit alors la visite décisive d’André Breton et des surréalistes dans son atelier. Il se lie avec les plus jeunes du groupe, comme José Pierre, participant aux ultimes expositions du mouvement comme {L’Ecart Absolu} en 1965.
Télémaque réalise des assemblages extrêmement précis de dessins, peinture, papiers collés, objets récupérés ou inventés. Sa pensée plastique, nourrie de son quotidien, de ses voyages, de ses relations avec Haïti privilégie la métamorphose des référents qui s’imbriquent dans un jeu de sens à la fois suggestif et énigmatique.
Dès 1962, laissant visible les tâtonnements du dessin puis simplifiant le trait à l’aide d’un épiscope, il juxtapose sur des fonds unis des silhouettes d’objets empruntées à des catalogues, des signes fréquemment contradictoires, des images trouvées dans la presse, des traces de dessin qui invitent le spectateur à établir des liens d’une signification à l’autre. En réaction à l’emprise grandissante du Pop Art américain, il conçoit avec Rancillac en 1964 l’exposition {Mythologies Quotidiennes}, présentée au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. La même année, ses premières expositions personnelles se tiennent chez Mathias Fels à Paris et à la Hanover Gallery à Londres. Il participe à des expositions marquantes comme {Documenta III} (1963) à Kassel, {La Figuration narrative} (1965), {Documenta IV} (1968).
En 1966, son répertoire technique évolue : il passe à la peinture acrylique, privilégie les aplats, affermit ses tracés qui deviennent plus réguliers et souples. De 1967 à 1970, il cesse de peindre pour réaliser des assemblages d’objets. Il revient ensuite au dessin, au collage,
au plaisir de la peinture et réalise la série des {Passages}, aux formes souples.
Il participe à 72/72 : {Douze ans d’art contemporain en France} (1960 – 1972) au Grand Palais en 1972. Sa première rétrospective se tient à l’ARC en 1976 et amène le soutien de Dominique Bozo auprès des musées.
Les séries des {Selles} et des {Maisons rurales} (1977-1980) affichent tout le processus de composition : le dessin préparatoire est juxtaposé à la toile en couleur, l’assemblage s’agrémente des éléments découpés qui ont servi à sa réalisation. Au cours des années quatrevingts, Télémaque réalise de grandes fresques pour des commandes publiques pour l’hôpital de la Salepêtrière (1984), la Cité des Sciences de La Villette (1986) ou la station Orsay du RER (1986). Le dessin se simplifie encore, des amorces de silhouettes suggèrent l’objet entier sans jamais l’achever.
Durant les années quatre-vingt-dix, il revient aux collages d’objets, d’affiches et au dessin au fusain, au marc de café, réalisant des formes sombres à la découpe élaborée. Les années 2000 sont celles d’un regard sur le monde, avec ses impressions au retour d’un voyage en
Afrique ou ses commentaires sur l’actualité politique, à travers des reprises de caricatures du journal {Le Monde}.
Son travail a fait récemment l’objet de nombreuses rétrospectives, tant en France (Espace Electra en 1995, Centre d’art de Tanlay en 1999, musée de la Poste en 2005) qu’à l’étranger (Johannesbourg en 1997, Valence en 1998).
Jan Voss
1936, Hambourg. Vit et travaille à Arcueil.
L’oeuvre de Jan Voss, en perpétuelle évolution (« j’ignore de quoi la prochaine toile sera faite » écrit-il) est marquée par la création d’espaces chaotiques et ludiques où le morcellement des objets, des figures tient lieu de structure. Les déambulations sur la toile
provoquent l’éclatement par la multiplication des éléments et des couleurs, avant d’offrir une nouvelle cohérence visuelle. Cette peinture joue avec les signes, mais ne suit aucune théorie.
Jan Voss fait ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Munich de 1955 à 1960. Il s’installe définitivement à Paris en 1960 où il collabore avec Christo à la revue {KWY} fondée par René Bertholo et Lourdes Castro. Repéré par les critiques lors de la troisième Biennale de Paris en
1963, sa première exposition personnelle se tient à la galerie du Fleuve à Paris en 1964 et sera suivie d’autres à Copenhague (1965, 1969, 1976), New York (1966, 1971), Milan, Munich (1970, 1974). Ses travaux semblent au début des années soixante assimilables à la Figuration
narrative (il est représenté à {Mythologies Quotidiennes}, {La Figuration narrative dans l’art contemporain}, {Bande dessinée et Figuration narrative}) mais les griffonnages, les pictogrammes, les personnages esquissés et objets dont il couvre ses toiles et dessins vont à l’encontre d’une narration construite. Ses peintures et dessins de saynètes, proches de l’univers de Paul Klee, ne génèrent aucun discours cohérent.
A partir de 1967, son travail s’ordonne en séries. Aux pictogrammes et symboles signalétiques souvent répétés s’adjoignent des objets usuels, des éléments emblématiques, des parties de corps (têtes, oreilles). Seule une ligne, sorte de fil conducteur, lie quelques éléments,
simulacre de narration.
Au début des années soixante-dix, l’espace devient le sujet principal de son travail. La figuration devient très allusive, la forme se libère. Sur un fond blanc, tout volume disparaît, des lignes aériennes colorent la toile. Leur enchevêtrement construit l’espace, ne restent que des amorces de silhouette. Les tracés créent un réseau fait d’entrecroisements qui se densifie à partir de 1977.
En 1978, se tient à l’ARC sa première rétrospective, {À portée de vue}.
Durant les années quatre-vingts l’espace se complexifie, des taches colorées aux formes aléatoires, des griffonnages en suspension envahissent et saturent l’espace, avec une jubilation enfantine. Tout semblant de composition disparaît à partir de 1983. Il colle des chutes de toile, des papiers froissés, traces d’oeuvres, de gestes et de supports passés. Cette approche nouvelle de l’espace trouve d’autres développements dans la réalisation de reliefs où se manifeste un plaisir particulier pour le bricolage, l’association de matériaux et de couleurs.
Des volumes (dossiers de chaise, toiles maculées, tasseaux colorés) et des empreintes s’agrègent à la toile, dépassant les limites de la surface plane. Les collages fragmentés créent des ruptures mais aussi des rythmes, des kaléidoscopes joyeux.
A partir de 1989, ces assemblages de plus en plus denses sont unifiés par le recouvrement d’une seule couleur : la monochromie de la série {Lieux-dit} calme ainsi un véritable champ de bataille de cageots, cartons, coupons de toiles.
Parallèlement, Voss applique sa réflexion au volume à travers des sculptures exposées dès 1992, faites de morceaux de bois récupérés de couleurs contrastées ou, au contraire, unifiées par une seule couleur et assemblées dans un savant chaos.
Les dernières années sont marquées par un retour à la ligne et aux aplats de couleur recouvrant la surface ou la cloisonnant, cette sérénité visuelle permettant à la virtuosité du trait de s’épanouir.
Retour au menu de l'exposition Figuration narrative
Entretien avec Bernard Rancillac
[...] Extraits du catalogue de l'exposition
Question : Quand vous montrez, en 1965 à la galerie Mathias Fels, la série « Walt Disney » où les tableaux apparaissent avec des aplats, sans trace de pinceau et dans des tons plus froids, vous êtes alors très critiqué dans la presse artistique.
Bernard Rancillac :
Oui, seul Gassiot-Talabot m’a soutenu. D’autres disaient que j’éliminais les éléments picturaux de l’oeuvre. Pour eux, je ne faisais plus de peinture. Il y a certainement eu une influence du Pop Art. Mais cela avait déjà commencé avant, j’avais pris mes distances avec la peinture parisienne. Je n’avais plus envie d’être un peintre abstrait, j’ai donc renoncé aux techniques picturales habituelles. Et Télémaque, qui peignait déjà dans des tons plus froids, a joué un rôle
primordial. Il avait une grande autorité sur les peintres de notre groupe, et m’a fortement influencé.
Je ne suis pas sûr que cette nouvelle manière ait rendu l’image plus efficace. On ne pouvait pas faire de grand format, faute de galerie adaptée. En France, faire du style "affiche" en peinture était très difficile, et on ne pouvait pas associer peinture et publicité. Ma peinture est devenue plus agressive et cela n’a pas plu. Nous voulions rester dans l’imagerie populaire. La réaction a été immédiate. Mathias Fels m’avait
même dit qu’il ne m’achèterait plus de toile, et je suis parti de chez lui pour entrer dans la nouvelle galerie Mommaton.
Question : Au même moment, en 1965, sont présentées les oeuvres collectives d’Eduardo Arroyo, Antonio Recalcati et Gilles Aillaud. Qu’en avez-vous pensé ?
Bernard Rancillac :
J’ai vu Une passion dans le désert en 1965 et Télémaque avait signé la pétition des surréalistes contre l’«Anti-Duchamp ». Pour ma part, j’étais plutôt content qu’on mette Duchamp par terre. En même temps, au nom de quoi ? Cela a été un combat perdu d’avance. Je ne suis pas sûr que ce soit de la bonne peinture. D’ailleurs, cela ne voulait pas en être. Je n’étais pas non plus contre les nouveaux réalistes. Bien sûr, j’allais à toutes les expositions de la rue des Beaux-arts, chez Iris Clert, et je me souviens avoir parlé avec Arman devant la galerie qu’il avait remplie de déchets. J’avais de la sympathie pour leur action. J’ai aussi connu Yves Klein par l’intermédiaire d’Aubertin. On avait à peu près le même âge et on essayait tous deux de « faire sauter la baraque ».
Pour les dirigeants de la Jeune Peinture, comme Aillaud ou Arroyo, le style, c’était la bourgeoisie. Je ne partage pas ce point de vue. Même Aillaud, qui disait « peindre comme une grand-mère », a fini par avoir un style.
Question : En 1965, vous participez pourtant au Salon de la Jeune Peinture…
Bernard Rancillac :
Aillaud et Arroyo venaient de prendre le pouvoir et ils sont venus nous chercher pour exposer au Salon, il leur fallait du monde. La presse, alors, n’a parlé que de nous. Deux ans plus tard, nous avons reçu de la part des dirigeants du Salon une lettre nous disant que nous n’étions plus invités à y participer. Plus qu’une question d’âge, c’était une question de stratégie. Pour eux, nous étions déjà
trop reconnus, contrairement à de plus jeunes peintres.
Question : Pouvez-vous préciser les différences que vous sentiez entre votre groupe et le groupe de la Jeune Peinture ?
Bernard Rancillac :
Leur méthode, quand ils se réunissaient, était de se demander :
« Que doit-on peindre ? » Et de répondre avec un programme bien déterminé. Par exemple, pour la « Salle Rouge » sur la guerre du Vietnam en 1968, il s’agissait d’exalter la victoire vietnamienne. On tombait dans le réalisme socialiste. Nous étions très différents, esthétiquement. Mais en dehors de ces divergences, nous étions
assez amis. Et politiquement, nous n’étions pas si éloignés les uns des autres.
Question : Votre idée était tout de même d’être le miroir de votre temps…
Bernard Rancillac :
Oui, mais pour parler des choses de notre temps il faut trouver une forme esthétique qui corresponde à l’actualité de notre discours.
Prendre des recettes académiques, que d’ailleurs le réalisme socialiste soviétique avait prônées (peindre à la manière du XIXe), ce n’était pas adapté, donc inacceptable.
Question : Ce qui vous irritait dans la Jeune Peinture, n’était-ce pas cet engouement pour l’anonymat, pour la disparition de l’individu ?
Bernard Rancillac :
Certainement. Dans les oeuvres collectives comme dans la « Salle
rouge », même si les artistes signaient, pas une toile ne contredisait les autres. Il y avait une ligne politique avec laquelle on ne plaisantait pas. Personnellement, je n’ai jamais été contre leur groupe mais pas non plus pour la peinture collective. Certains l’ont mal pris.
Question : En 1967, votre exposition intitulée L’Année 1966, galerie Blumenthal-Mommaton, marque une rupture nette avec les thématiques des années précédentes. C’est la première grande série de peintures faites d’après photographies.
Bernard Rancillac :
Oui, c’est capital, c’est même la photographie qui m’a amené à
peindre la politique. Je me suis dit que, pendant un an, j’allais faire des toiles sur les événements de l’année. Une sorte d’expérience, pas seulement politique. Je voulais m’opposer à cette idée que la peinture n’a rien à voir avec l’événement, avec l’Histoire, qu’elle est intemporelle, qu’elle doit rester pure, neutre.
Personnellement, il me semble que la peinture doit être contemporaine, ce que montre tous ceux que l’on appelle les grands peintres : ils ont vécu leur temps avec intensité, leur peinture est un miroir de ce qu’ils ont vécu et de la façon dont ils l’ont vécu. Je voulais m’opposer à ce principe atemporel de la peinture abstraite.
Tout en peignant d’une façon nouvelle. En utilisant des documents comme la presse, la photographie, la pub.
[...]
Retour au menu de l'exposition Figuration narrative
Entretien avec Hervé Télémaque
[...] Extraits du catalogue de l'exposition
Question : Peut-on dire que c’est le pop qui vous amène à "refroidir la peinture", pour reprendre un terme d’Anne Tronche ?
Hervé Télémaque :
Le "refroidissement " avait déjà commencé avant par les influences des
médias, même si au fond je ne les avais pas vraiment, pas consciemment regardés. Comment se fait-il qu’à l’époque où je suis à New York, la ville moderne n’ait apparemment aucune influence sur moi ? Je trouvais Time Square extraordinaire mais l’idée ne m’est jamais
venue d’exprimer quelque chose concernant cet endroit. En revanche, ce qui m’intéresse, ce qui me frappe à Paris, c’est la rapidité du langage dans les arts dits commerciaux - comics, publicité, cinéma -, rapidité que je n’ai pas dans la peinture, d’où mon admiration pour Hergé.
L’importance que je porte à Hergé vient de cette rapidité. Comment
dessiner les choses vite, au fond comme un cinéaste. Nous sommes en plein dans tout cela, nous sommes des cinéphiles insatiables ! A New York, j’allais quatre fois par semaine au cinéma, à Paris, je fréquente la cinémathèque. J’ai souvent pensé à l’époque à quitter la peinture pour le cinéma, car elle m’apparaissait comme un médium vieillot, archaïque,
rustique.
Question : Dans un entretien avec Jacques Gourgue, vous parlez de la « trahison des valeurs sensibles de la peinture » et dites « On ne cherchait pas à être des artistes ».
Hervé Télémaque :
Il fallait abandonner toute la noblesse picturale qui me paraissait
désuète. Ce qui prime, c’est l’idée de l’efficacité. On cherche à raconter. La belle peinture, la noblesse picturale ne m’intéresse pas. D’ailleurs on se fait insulter par les aînés. Et pourtant, j’ai eu beaucoup de chance car j’ai été amené à la galerie Mathias Fels par Corneille, et François Arnal me fait tout de suite entrer à la galerie Legendre.
Mais, d’emblée tout cela me parait vieillot. Avec Bertholo et Jan Voss, nous sommes des dessinateurs et dans la quête de l’abandon de la pâte picturale.
Question : Est-ce cela le point commun avec le pop : l’abandon des qualités tactiles de la peinture ?
Hervé Télémaque :
Oui, nous avons les mêmes urgences expressives.
Question : Et pourtant vous évoquez parfois le « formalisme » Pop ?
Hervé Télémaque :
Après coup, je me rends compte que les Américains ne s’intéressent pas du tout à ce qui nous préoccupe ici, c'est-à-dire à la politique. Même diffus, il y a un fil conducteur politique dans nos préoccupations : guerre d’Algérie, Vietnam, Jean-Paul Sartre, les positions intransigeantes des surréalistes sur la révolution, voilà la différence - d’importance - entre Paris, New York et Londres. Nous revendiquons un regard critique sur la société qui n’existe pas chez les Américains. Seul Rosenquist est proche
de nous – politiquement - c’est pourquoi nous l’invitons à Bande dessinée et figuration narrative. Gérald Gassiot-Talabot fait venir des Etats-Unis le grand tableau de Rosenquist, F.111. C’est très important, c’est la première fois que l’on montre un tableau américain de cette envergure. Quant au nouveau réalisme, il nous apparaît comme un
discours plat, terre à terre, sociologique. Nous voulons aller au-delà du sociologique.
Nous nous identifions à notre époque, nous tentons de la raconter, de raconter notre vie à travers des signes « parlants ». Prenons un exemple qui me concerne, Banania, objet/symbole/signe chargé d’une histoire coloniale. J’ai développé cette idée que l’objet, à la fois support et prétexte à l’autobiographie, doit contenir sa propre contradiction interne, comme un coffre-fort. A la fois lumineux et sombre. Je suis à
l’opposé d’Arman en faisant parler ces objets. J’essaie de créer une narration complexe, à partir d’objets « paradoxaux », qui soit stimulante pour l’esprit mais qui me conduise à l’abandon du beau. N’oublions pas que je suis passé de Gorky à Chirico, lequel m’a appris à regarder. Je découvre Duchamp par Chirico, par Magritte mais aussi par la sexualité qui est, au fond, le moteur de ma peinture. Disons que ma peinture prend comme véhicule la sexualité et que je trouve chez Duchamp tout ce vocabulaire sexuel, toute cette articulation ironique. Et quand je découvre le magazine Elle, les soutiens-gorge, les culottes, je jette tout ça sur les tableaux. A New York, je n’aurais peut être pas osé le faire et Duchamp était, sans aucun doute, un maître dangereux. La sexualité est une chose grave et quand on lui posait la question sur sa propre sexualité, il répondait « sombre » !
Question : Donc, la question de la narration reste fondamentale ?
Hervé Télémaque :
Oui, elle est fondamentale. Je suis effectivement un narratif, et je
pense que Gérald Gassiot-Talabot qui l’avait bien perçu, respectait justement la complexité de ma narration, même s’il n’aimait pas particulièrement ma facture sobre.
[...]