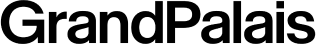Manet–Velázquez
La manière espagnole au XIX<sup>e</sup> siècle
Du 17 septembre 2002 Au 5 janvier 2003
- Description
Cette exposition bénéfice en France du soutien d’ABN
AMRO.
Elle est organisée par la Réunion des musées nationaux,
le musée d’Orsay à Paris et le Metropolitan Museum of Art
à New York, en collaboration avec le musée du Prado à
Madrid.
En partenariat média avec Mezzo et Figaroscope
Au retour d’un bref séjour à Madrid, le 14 septembre 1865,
Manet écrit à Baudelaire que Velázquez "est le plus
grand peintre qu’il y ait jamais eu". Fasciné par l’Espagne,
il est venu juger sur place la manière de peindre d’un artiste
essentiellement exposé au musée royal de Madrid.
Présentée au musée d’Orsay, puis au Metropolitan
Museum of Art de New York, l’exposition se propose de montrer l’évolution
que connait la peinture du XIXe siècle, qui abandonne progressivement
les règles de l’académisme et la technique issue de Raphaël
pour les remplacer par une facture plus libre, permettant de mieux saisir
la réalité et de donner l’impression de la vie par les
touches de couleurs. Ce n’est donc pas une présentation de l’Espagne
vue par les voyageurs, même si le thème des courses de taureaux
peint par Goya, Dehodencq et Manet, figure dans l’exposition.
Consacrée, pour un tiers, à la manière espagnole de
Manet, avant et après son voyage en Espagne, l’exposition présente
aussi des œuvres de ses aînés, contemporains et amis, précédées
de quelques-unes des peintures espagnoles appréciées par les
artistes français au cours du XIXe siècle.
Une place de choix est faite à Goya, héritier de Velázquez
et dernier grand peintre de cour, connu dès l’époque romantique
par ses Caprices qui inspirèrent Delacroix, et, plus tard, Constantin
Guys et Manet.
L’art espagnol, peu exposé en France avant la Révolution,
fait son apparition au Louvre, après les guerres napoléoniennes
en 1814-1815, avec des chefs-d’œuvre de Ribera, Murillo et Zurbaran,
renvoyés à Madrid à la suite du Congrès de Vienne.
Pour qu’une véritable familiarité se confirme, il faudra
attendre la Galerie espagnole de Louis-Philippe, installée au Louvre
de 1838 à 1848, pour découvrir plus de 400 tableaux, lesquels
seront ensuite dispersés à Londres en 1853. On y admire des
Goya avec les Jeunes (Palais des Beaux Arts de Lille) et les Majas
au balcon, mais la grande révélation est alors la peinture
de Zurbaran dont le Saint François en méditation (Londres,
National Gallery) est la vedette. Deux tableaux de Corot (musée du
Louvre) et de Manet (Fine Arts Museum, Boston) s’en inspirent directement.
Millet peint Sainte Barbe (musée des Beaux Arts d’Angers)
à la manière d’un Ribera.
Cependant, l’artiste le plus adulé est Murillo. Après
la perte de la Galerie espagnole, le Louvre acquiert à grands frais,
en 1852, l’Immaculée Conception de Murillo (musée
du Prado, depuis l’échange de 1941), mais aussi de plus modestes
peintures, comme la Réunion de treize personnages que l’on
croit de Velázquez et qui inspire à Manet copies et variations,
dont l’Enfant à l’épée (Metropolitan
Museum of Art, New York).
La peinture espagnole donne l’exemple d’un réalisme extrême
avec ses mendiants, ses bouffons, ses infirmes et ses martyrs. Les réalistes
français y trouvent matière, non seulement pour des sujets modernes,
mais aussi pour une nouvelle peinture d’histoire, que l’on observe
dans la carrière de quelques-uns des amis de Courbet, Bonvin, et Manet,
comme Legros fasciné par Zurbaran, et Ribot qui passe pour un nouveau
Ribera.
D’autres artistes, Carolus Duran ou Bonnat, fortement marqués
par leur séjour en Espagne, sont aussi présents dans l’exposition,
le premier par un Autoportrait (musée du Prado, Madrid) qui
ressemble à un Velázquez, le second par le Job du Salon
de 1880, ridé à la manière d’un Ribera. Quant à
Henri Regnault, brillant prix de Rome, il quitte la Villa Médicis pour
poursuivre en Espagne ses travaux de pensionnaire ; témoin d’une
nouvelle révolution à Madrid, il peint le monumental portrait
de Juan Prim ; 8 octobre 1868, (musée d’Orsay) inspiré
à la fois par Goya et Velázquez. Ce tableau, placé à
l’entrée de l’exposition, résume la situation politique
mouvementée de l’Espagne au XIXe siècle. Et
c’est au Goya du Dos de Mayo que fait écho l’Exécution
de Maximilien de Manet (version de Boston).
Les prêts du Metropolitan Museum of Art, co-organisateur de l’exposition,
sont particulièrement importants pour l’art espagnol et Manet.
Ils permettent de suivre l’artiste à travers les Salons qui ont
précédé son voyage en Espagne, avec le Guitarero
du Salon de 1861, les deux tableaux qui encadraient Le Déjeuner
sur l’herbe au Salon des refusés de 1863 - Mlle Victorine
en costume d’espada et Jeune Homme en costume de majo -, le
Christ aux anges du Salon de 1864, ainsi que l’Enfant à
l’épée de 1861, dont Zola écrivait justement :
"On dit qu’Edouard Manet a quelque parenté avec les maîtres
espagnols, et il ne l’a jamais avoué autant que dans l’Enfant
à l’épée".
Le musée du Prado prête quatre Velázquez dont le Bouffon
Pablo de Valladolid, qui inspire à Manet, après son retour
de Madrid, l’Acteur tragique (National Gallery of Art, Washington)
et le Fifre (musée d’Orsay), Menippe que l’on
retrouve dans ses deux Philosophes (Art Institute, Chicago), le Nain
el Primo avec un livre ouvert qui rappelle Emile Zola (musée
d’Orsay) où Manet a pris soin de placer une gravure de Goya, d’après
les Buveurs de Velázquez (musée du Prado).
L’Artiste (musée de Sao Paulo), refusé au Salon
de 1876, est un ultime clin d’œil aux portraits de Philippe IV
en chasseur de Velázquez. Si, dans cette effigie d’un familier
- le bohême Marcellin Desboutin -, Manet atteint une nouvelle
maîtrise de la touche jetée, en délaissant les gris de
l’Acteur tragique pour faire jouer les ocres et les bruns avec
le noir, - il n’en reste pas moins fidèle au réalisme espagnol
qui sait donner de la dignité à la misère.